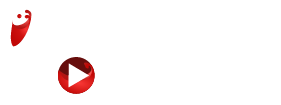C’est au cœur de la Foire aux Vins, qu’a été semée une graine pour la viticulture française. Invité par le Crédit Agricole Alsace Vosges, Ronan Raffray, professeur de droit privé à l’Université de Bordeaux et spécialiste du droit vitivinicole, animait une conférence sur le thème : « Progrès social et environnemental dans la viticulture. Les voies multiples de l’appellation d’origine durable ». La conférence c’est tenue jeudi 31 août au matin, et a réuni un public de professionnels, vignerons et curieux venus nombreux explorer les défis contemporains du vin.
Une intuition marginale devenue sujet central
C’est presque par accident qu’est née l’idée d’“appellation d’origine durable” (AOD). Lors d’un atelier de design fiction, Ronan Raffray, professeur de droit à l’Université de Bordeaux, imagine une fusion conceptuelle entre qualité d’origine et responsabilité environnementale. Ce juriste, pourtant plus habitué aux amphithéâtres qu’aux caves viticoles, ne s’attendait pas à ce que son scénario de prospective viticole suscite un tel engouement. Et pourtant, l’idée séduit aussi bien les étudiants que les professionnels du vin, et finit par faire l’objet d’un article dans la revue spécialisée Vitisphere. Elle reçoit un accueil enthousiaste : des producteurs, chercheurs, journalistes et même des collectifs de vignerons prennent contact. Une simple hypothèse devient ainsi un sujet de débat stratégique pour l’avenir du secteur.

Le basculement de l’origine vers l’environnement
Le système des AOP (Appellations d’Origine Protégée) repose historiquement sur deux piliers : le terroir et la typicité. Ce cadre normatif a longtemps laissé les enjeux environnementaux hors champ. Mais aujourd’hui, les crises climatiques, la pression sociétale et l’évolution des normes européennes poussent à réconcilier origine et durabilité. Le nouveau règlement européen de 2024 permet explicitement l’intégration des pratiques durables dans les cahiers des charges, sous certaines conditions. En France, l’INAO a ouvert la voie dès 2016 avec l’introduction de mesures agroenvironnementales type. L’appellation devient ainsi un levier de transition agricole, capable de conjuguer qualité gustative, respect des écosystèmes et développement territorial.
La typicité en pleine transformation
La typicité, traditionnellement mesurée par les caractéristiques organoleptiques d’un vin, est elle aussi en mutation. Aujourd’hui, de plus en plus de voix (scientifiques, producteurs, experts) défendent l’idée d’une “typicité globale”, intégrant l’ensemble des conditions de production, y compris sociales et environnementales. L’exemple du classement des crus de Saint-Émilion, qui tient compte des certifications environnementales et du plan carbone des exploitations, illustre cette évolution. Un vin devient typique non seulement par son goût, mais aussi par le soin apporté à son écosystème. Cette vision globale de la typicité renforce la légitimité d’une appellation d’origine durable, à la fois plus exigeante et plus lisible pour les consommateurs.

Une évolution juridique déjà en marche
Le droit français et européen n’est plus aussi rigide qu’avant sur la séparation entre origine et durabilité. Depuis 2010, les ODG (organismes de gestion) peuvent adopter des chartes de bonnes pratiques environnementales. Et dès lors qu’une mesure est inscrite dans un cahier des charges, elle devient contraignante pour tous les producteurs de l’appellation. Ainsi, la frontière entre “droit dur” et “droit souple” se déplace, rendant possibles des formes hybrides d’appellations, à mi-chemin entre AOP classique et certification RSE. Cette dynamique est encore volontaire, mais elle pourrait devenir structurante si elle s’accompagne d’un outil clair, collectif et crédible : l’AOD.
Vers une nouvelle fonction de l’appellation
L’appellation d’origine, historiquement outil de protection du produit, devient désormais garante du milieu d’origine. Elle se mue en instrument de préservation des ressources naturelles, avec une vocation sociale et territoriale affirmée. Les récents travaux de l’INAO, ainsi que les orientations européennes, vont dans ce sens. Le guide de traitement des dossiers publié en 2023 permet d’intégrer des critères liés au climat, à la biodiversité ou à la santé des sols dans les processus de reconnaissance. Des dispositifs d’innovation permettent même d’expérimenter de nouvelles pratiques sans perdre le bénéfice de l’AOP. La viticulture devient un laboratoire vivant de résilience réglementaire, appuyé sur la notion de terroir durable.

De l’idée à la reconnaissance institutionnelle ?
Alors que certains vignerons envisagent de construire leur reconnaissance sur la base d’une durabilité forte, la question se pose : faut-il substituer l’AOD à l’AOP, ou simplement enrichir cette dernière ? La réponse n’est pas tranchée. Mais la perspective d’une appellation d’origine durable offre un cadre cohérent, clair et crédible, capable de répondre à la demande de transparence, d’éthique et de sens. La durabilité ne serait plus un supplément d’âme, mais une condition constitutive de la qualité du vin. Une révolution en cours, qui pourrait bien redéfinir ce que signifie “boire un bon vin” à l’horizon 2050.